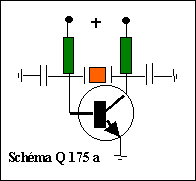
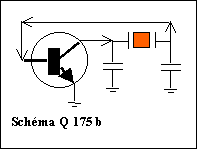
Question n°
173
A quelle puissance
reçue correspond le signal S9 ? Chaque point S correspond-t-il à
un écart précis ?
Réponse
Il n’y a pas de norme,
mais l’habitude est de prendre , pour S9 :
* HF : -73 dBmW ou
50 picoWatts (et donc 50microVolts sur 50 Ohms) ;
* VHF : -93 dBmW ou
500 femtoWatts (et donc 5microVolts sur 50 Ohms).
*6dB d’écart
entre 2 points S.
Question n°
174
Mon récepteur
va de 30 kHz à 30 MHz. Or, j’ai l’impression qu’il ne se passe rien
en dessous de 100 kHz. Est-ce parce que les bandes y sont vides ou parce
que mon récepteur est « sourd» à ces fréquences
? Que trouve-t-on sous 100 kHz s’il y existe quelque chose ?
Réponse
Il y a des stations
en dessous de 100 kHz (communication avec les sous marins, stations à
vocation scientifique). En revanche, la performance de réception
diminue rapidement avec la réduction de la fréquence : nos
antennes d’amateur sont beaucoup trop courtes et le bruit est important.
Par ailleurs, sachant qu'il ne s'agit pas d'une bande très écoutée,
certains constructeurs semblent avoir des difficultés à obtenir
les caractéristiques de sensibilité telles que spécifiées
(nous avons mesuré, par exemple, sur un TS930, une sensibilité
bien plus réduite en dessous de 1,5 MHz qu’au dessus).
Question n°
175
J’ai trouvé
un schéma d’oscillateur à quartz qui ne comporte que très
peu de composants : un transistor, un quartz, 2 résistances
et deux condensateurs (cf. schéma Q 175 a). Il marche, mais je me
demande à quoi servent les deux condensateurs (certainement utiles,
car cela n’oscille plus quand je les enlève), le quartz devrait
en effet suffire à renvoyer l’oscillation du collecteur vers
la base et à entretenir l’oscillation. En quoi mon raisonnement
est-il faut ?
Réponse
Les deux condensateurs
servent à adapter les impédances entre la sortie du signal
par le collecteur et l’entrée par la base.
On peut se représenter
l’ensemble formé par le quartz et les deux condensateurs sous forme
d’un circuit en PI (cf. schéma Q 175 b) classique comme on en trouve
entre la sortie d’un étage final à tube et une antenne par
exemple : il s’agit bien, comme ici, d’un transformateur d’impédance.
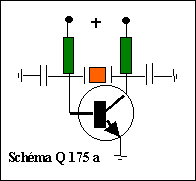 |
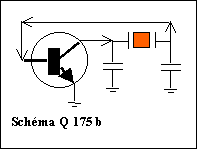 |
Question n°
176
Jean-Pierre
demande : « à la question qui demandait s’il fallait qu’une
antenne « ground-plane» soit toujours disposée brin
rayonnant vers le haut et plan de sol vers le bas, vous aviez répondu
que oui ; or, à l’occasion d’un colloque à Munich, j’ai vu
dans la salle des congrès deux antennes « ground-plane »
visiblement en ondes centimétriques, au plafond et la tête
en bas (cf. schéma Q 176). Pourquoi cette différence avec
ce que vous indiquiez ? »
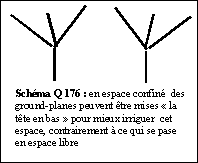 Réponse
Réponse
La réponse
que nous avions donnée concernait le trafic amateur, donc le trafic
en espace libre et donc pour rayonner le plus loin possible. Dans une salle
de congrès, c’est exactement le contraire qui se passe.
On est en milieu confiné,
on cherche à irriguer au mieux l’ensemble de la salle (pour la traduction
simultanée) et surtout pas à l’extérieur de la salle.
La disposition tient alors compte des structures de la salle à l’intérieur
de laquelle on est. Les antennes sont placées en procédant
à des essais pour optimiser l’ensemble et on peut très bien
arriver à la disposition que vous évoquez.
Auteurs :
les réponses de ce mois ont été préparées
par Jean-Pierre (F6BPS), André (F8BPS) et Jean-Pierre (F6FQX).